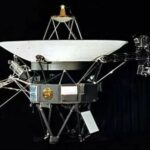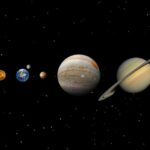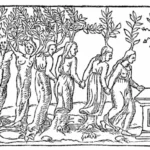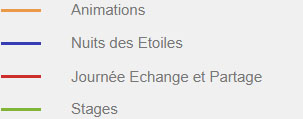Les Cadrans de l’Horloge Astronomique de Beauvais

Dans cet article, nous vous proposons une revue des différents cadrans qui composent la magnifique Horloge Astronomique de Beauvais. De fait, c’est un indispensable si vous souhaitez visiter la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais !
(Photographies de l’auteur, sauf celle de la façade gauche).
A quelques kilomètres de l’observatoire de Rouvroy-les-Merles trône dans le transept nord de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais une des plus belles horloges astronomiques au monde.
Cette œuvre est due à Monsieur Auguste-Lucien VÉRITÉ (1806-1887) sur la commande de Monseigneur Joseph-Armand Gignoux (1799-1878), évêque de Beauvais. L’horloge astronomique de Beauvais fut réalisée de 1865 à 1868. Ce monument néo byzantin de 12 mètres de haut, de 5,12 mètres de large sur 2,82 mètres de profondeur, aux 90 000 pièces d’horlogerie, a donc été réalisé en trois ans.
L’horloge a déjà fait l’objet d’une littérature générale abondante, tant sur le papier qu’en ligne.
Aussi peut-il être intéressant pour nous astronomes de se concentrer sur ses cadrans.
Le concepteur :
Auguste-Lucien VÉRITÉ fut autodidacte, d’abord comme facteur d’orgues, puis comme horloger pour le compte de sa ville. D’une grande rigueur, sa réputation l’amena d’abord à être employé en tant qu’ingénieur par la compagnie des chemins de fer du Nord pour surveiller tous les instruments de mesure du réseau. En 1850 il réalise l’horloge astronomique de Besançon, d’une qualité telle que ce furent les Beauvaisiens eux-mêmes qui sollicitèrent les autorités ecclésiastiques afin qu’un ouvrage comparable leur soit mis à disposition.
Les cadrans en détail :
I- Le cadran principal
Le grand cadran de l’horloge donne l’heure officielle. Il présente la particularité de ne pas être divisé en douze mais en vingt-quatre heures pour la petite aiguille. Un soleil symbolise le passage à midi dans la partie inférieure du cadran, et la Lune à minuit dans la partie haute. La grande aiguille quant à elle fera bien un tour complet en soixante minutes.
Sur le plan ornemental, le fonds est constitué d’un Christ Pantocrator rappelant sa maitrise du temps par l’Alpha et l’Omega tenus dans sa main gauche. Douze médaillons d’Apôtres entourent l’ensemble.
II- Les baies de la façade avant
A- La baie centrale
Sous le cadran principal que venons de présenter se trouvent disposés douze autres cadrans qui constituent la baie du milieu. C’est-à-dire, d’une part un cadran du milieu, lequel surmonte le pendule de 45 kilogrammes. Et d’autre part onze cadrans accessoires, répartis en cascade tout autour de ce cadran central.
1°) Le cadran du milieu
Le cadran du milieu est un outil à visée surtout religieuse. Il montre cependant par certains aspects un intérêt pour l’astronome. C’est le cadran dit du comput ecclésiastique.
Il est fait d’un fond d’émail bleu, garni de cinq alignements circulaires et concentriques de médaillons d’émail blanc. Du centre partent cinq aiguilles de longueur variable, chaque aiguille pointant donc sur un cercle à l’exclusion des autres.
Du plus grand au plus petit, seront alors indiqués chaque 31 décembre à minuit et pour toute l’année à venir :
- Les vingt-huit indications du cycle solaire,
- La série des lettres dominicales,
- Le nombre d’or du cycle lunaire (sans rapport avec le nombre d’or mathématique), soit en l’occurrence une indication astronomique utilisée à des fins religieuses. Le cycle lunaire complet forme en effet une période de dix-neuf ans, soit 235 lunaisons, à l’issue desquelles les nouvelles Lunes arriveront aux mêmes époques qu’à la première année du cycle, ce que l’astronome grec Méton d’Athènes avait déjà démontré 433 ans avant notre ère.
- L’épacte,
- Et enfin l’indiction romaine.
2°) Les cadrans périphériques
Les autres cadrans de la baie centrale comprennent respectivement :
- Au-dessus du cadran principal, celui donnant l’heure sidérale, c’est-à-dire celle tenant compte de la durée réelle de rotation de notre planète, de 23 heures 56 minutes et 4 secondes.
- Et tout aussi important pour l’astronome, le cadran de l’équation du temps : celui-ci nous donne chaque jour le nombre de minutes à ajouter ou à retrancher par rapport au midi légal pour connaître l’heure exacte à laquelle le Soleil franchit le méridien local.
Rappelons en effet que ces deux notions, le midi solaire et le midi légal, ne coïncident que quatre fois dans l’année, soit 15 avril, le 13 juin, le 1er septembre et le 25 décembre, et que ce décalage est dû à deux phénomènes : d’une part, l’accélération de la révolution de la Terre en périhélie (à l’approche du Soleil) et son ralentissement en aphélie (en s’éloignant du Soleil), c’est la deuxième loi de Kepler ; d’autre part, l’inclinaison de l’axe de rotation de le Terre, et donc la variation de la durée du transit apparent du Soleil.
- La jauge de la déclinaison du soleil par rapport à l’équateur céleste : une aiguille droite, soit 0° aux équinoxes (Cela signifie que le soleil et en face de l’équateur céleste, et lorsqu’il croise en plus l’écliptique à l’aplomb du premier point vernal, c’est l’équinoxe de Printemps), donne chaque jour cette déclinaison, pour atteindre +23°28’ (données du XIXème siècle) dans la partie droite/boréale du cadran, donc au solstice d’été, et l’inverse, -23°28’ en partie gauche/australe au solstice d’hiver.
- En rang inférieur, deux cadrans donnent respectivement la durée du jour et de la nuit, chaque jour de l’année, à la latitude de Beauvais.
- Dans le rang encore inférieur, un cadran divisé en quatre indique simplement les saisons, et de l’autre côté de l’axe du pendule, en vis-à-vis, un cadran divisé en douze segments permet par son aiguille unique de localiser le soleil dans le signe du zodiaque qu’il traverse présentement.
- En dessous, nous aurons de part et d’autre de l’axe du pendule, à gauche l’heure et la minute de lever du Soleil, à droite l’heure et la minute de son coucher.
- Enfin, dans le rang encore inférieur, à gauche le cadran des jours de la semaine, à droite celui des planètes qui leur ont donné leurs nom.
B- La baie de gauche
1°) Le cadran supérieur
Toujours en partant du haut, nous rencontrons d’abord un cadran de conception géocentrique, qui reproduit les heures de lever et de coucher du Soleil. Il complète donc celui évoqué ci-dessus, lequel se contente juste de les indiquer.
Une terre est représentée comme petit globe, droite et donc sans tenir compte de son inclinaison, avec trois lignes en or, l’une au niveau de l’équateur -c’est la ligne équinoxiale-, et deux autres au-dessus et en dessous de la Terre. Ce sont les lignes des solstices.
Un fil d’or vertical représente le méridien de Beauvais. Une couronne, divisée en vingt-quatre heures, entoure le cadran. Un Soleil mobile à l’intérieur de cette couronne en fait le tour en une journée. Deux tiges en métal partent également de la Terre, l’une appelée heure de lever du Soleil, l’autre, heure de coucher du Soleil.
Chaque jour donc, en fonction de l’évolution du Soleil, une de ces tiges donnera l’heure du lever, l’autre celle du coucher.
Précisons enfin que l’auteur a prévu un mécanisme pour que chaque jour le petit globe s’ajuste parfaitement sur le midi vrai en fonction de l’équation du temps que nous avons vu plus haut…
2°) Les cadrans centraux
En dessous se trouve un groupe de neuf cadrans. Au centre, l’heure du méridien de Paris, tout autour, huit cadrans donnent l’heure des grandes villes qui sont à l’ouest de Beauvais, ainsi que de Cayenne ou Tahiti.
3°) Le cadran inférieur
Enfin et pour clore cette baie, dans la partie basse se trouve une couronne calendaire sur laquelle une grande aiguille d’or se déplace à minuit chaque jour.
L’aiguille pointe donc le jour de l’année dans lequel nous sommes. L’auteur a bien prévu vingt-neuf jours pour le mois de février tous les quatre ans, et son mécanisme tient même compte des années qui pourraient être bissextiles mais qui ne le seront pas, parce que le nombre de leurs dizaines ne se divise pas par quatre (1700,1800,1900, 2100)…
Le fonds de ce « calendrier-cadran » est tout aussi intéressant et se présente en trois lobes, tous dédiés à la Lune. Soit respectivement : les phases de la Lune, son âge, et l’heure moyenne de son passage au méridien de Beauvais.
C- La baie de droite
1°) Le cadran supérieur
Pour de plus amples informations sur ce dernier point, et pour connaître donc l’heure précise de passage de la Lune au méridien de la ville, l’astronome se reportera alors au cadran supérieur de la baie de droite, qui est le pendant de celui de la baie de gauche, avec le même agencement « couronne horaire/globe terrestre au centre du cadran/méridien local ».
Le cadran dispose de deux aiguilles : 1°) Une aiguille dorée qui indique l’heure de passage de la Lune au méridien de Beauvais, et 2°) Une aiguille noire, qui se termine par une Lune. Mais une Lune vue de dessus, avec sa face apparente et sa face visible, et de surcroit mobile autour de l’extrémité de son aiguille, pour indiquer les phases.
Lorsque les deux aiguilles se superposent, il suffit alors de lire l’heure indiquée par l’aiguille dorée pour connaître l’instant où la Lune culmine au méridien sud local.
Toujours par le même raisonnement, lorsque l’alignement a une configuration « Face obscure vers Terre/Méridien/Terre », il suffit de lire l’heure donnée par l’aiguille dorée pour constater l’heure de la nouvelle Lune.
Chaque lendemain à la même heure, l’aiguille noire présentera comme il se doit un retard de 46 minutes 48 secondes par rapport à la veille, et ainsi de suite le jour suivant. Et la Lune tournera un peu chaque jour sur elle-même pour aller de croissant en quartier, etc, jusqu’à la prochaine lunaison…
2°) Les cadrans centraux
En dessous, nous retrouvons un groupe de neuf cadrans, avec cette fois au centre l’heure de Rome, et tout autour les heures de huit villes à l’est de Beauvais. Remarquons que puisque l’horloge est dans le transept nord de la cathédrale, il était logique de mettre les heures à l’occident de Paris dans la baie de gauche, et celles à l’Orient, donc de Rome, dans la baie de droite…
3°) Le cadran inférieur
Le dernier cadran de cette baie est particulier en ce qu’il est constitué d’une aiguille, d’une couronne calendaire, et de trois indicateurs chiffrés. Il est exclusivement à usage religieux, afin de connaître :
- L’âge du Monde depuis Moïse,
- Le millésime de l’année courante,
- Le siècle courant, bissextile ou non.
L’instrument indique par ailleurs automatiquement chaque 31 décembre à minuit, et pour la nouvelle année, toutes les dates des fêtes mobiles qui sont liées à Pâques (lequel a lieu le premier dimanche après la première pleine Lune qui suit le 21 mars).
III- Les façades latérales
Les façades latérales sont les plus intéressantes pour l’astronome. Hélas, elles ne sont guère visibles (hormis une visite spéciale), ce qui est fort regrettable 1. Elles se divisent chacune en trois parties.
A- La façade gauche (en regardant l’horloge)
De haut en bas :
1°) Auguste Lucien VÉRITÉ avait conçu un cadran divisé en vingt-quatre heures indiquant les éclipses solaires susceptibles de survenir à Beauvais. Schématiquement la terre, en rotation sur elle-même en vingt-quatre heures, y figure au centre. Un soleil en or est fixé dans la partie supérieure du cadran, à la fin d’une ligne verticale qui passe par le centre de la Terre. Cette ligne, c’est encore le méridien de Beauvais.
Une Lune est portée à l’extrémité d’une tige métallique mobile, et opère une révolution en un mois lunaire autour de la Terre. Si au moment de l’exacte nouvelle Lune, la petite Lune est un peu en avance ou un peu en retard sur le méridien alors il n’y a pas éclipse, ou éclipse partielle. Inversement, si la nouvelle Lune est pile sur le méridien il y a éclipse solaire totale.
Deux remarques s’imposent :
Tout cela implique que VÉRITÉ maîtrisait à lui seul les calculs de mécanique céleste en tenant compte de l’obliquité de la Lune de 5% par rapport à notre équateur, et donc ses nœuds ascendants et descendants.
Il les maîtrisait tellement bien que l’observatoire de Paris n’ayant publié de tables des éclipses que jusqu’à l’année 1900, VÉRITÉ avait prévu un petit mécanisme modifiant l’alignement des pignons pour que le cadran soit mis à jour au-delà de cette date et à chaque fin de siècle…
2°) Le cadran central indique les heures de pleine mer et l’amplitude de la marée au Mont Saint-Michel. C’est l’un des cadrans animés en fonction des grandes marées avec un bateau en mouvement devant le mont.
3°) Les planisphères célestes : Sur la partie inférieure de chacune des deux façades latérales sont représentées deux voutes célestes de Beauvais, l’une au zénith (façade droite), l’autre au nadir (façade gauche). Il s’agit de la préfiguration des cartes qui sont remises aujourd’hui aux amateurs lors des nuits des étoiles, les « montre-ciel », fournis avec la revue « Ciel et Espace » à cette occasion.
L’horizon est donc elliptique autour du point central que forme, soit le pôle céleste nord (façade de droite), soit le pôle céleste sud (façade de gauche). Bien sûr, la voute céleste est mobile, fixée sur une plaque de verre qui opère un tour complet en un jour sidéral. L’autre partie du cadran, de forme elliptique, est donc fixe. On retrouve sur le ciel toutes les indications les plus importantes, que l’on regarde vers le haut ou vers le bas, avec les graduations en heures de l’ascension droite, l’équateur céleste, les tropiques, l’écliptique, le cercle circumpolaire. Toutes les étoiles visibles jusqu’à la sixième magnitude y sont représentées avec une précision incroyable, et l’auteur n’a bien sûr pas omis de dessiner la voie lactée.
Or, cet auteur n’est pas Auguste-Lucien VÉRITÉ. Il est mentionné dans la description de l’horloge, parue en 1876, que les voutes célestes sont l’œuvre de Monsieur Léon FENET, dessinateur employé des Tapisseries de Beauvais, et, à ce titre, réalisées à ses heures perdues.
Ce Léon FENET n’est pas un inconnu, car postérieurement à la parution du livret, il s’intéressa à l’archéologie. Surtout, il développa de grands talents de photographe, arpenta à ce titre les villages de l’Oise, pour réaliser des représentations de châteaux, églises, mairies, dolmens… Il fut également l’un des premiers astrophotographes lunaires, de grande renommée 2.
On le compte d’ailleurs parmi les premiers membres de la Société Astronomique de France, lors du diner de fondation auquel Camille Flammarion avait convié douze (!) astronomes, amateurs et professionnels, rigoureusement sélectionnés, le 28 janvier 1887 3. Ce fut enfin un dessinateur sélénite très méticuleux, puisqu’on lui doit la célèbre carte de la Lune, fameuse « carte de Flammarion » dont le fac-similé est désormais un best-seller de la décoration 4 .
Au même titre que Auguste-Lucien VÉRITÉ, Léon FENET est d’ailleurs représenté par une statuette de bois parmi les décorations de l’horloge, dans une petite niche. Cela était certes à la mode depuis VIOLLET-LE-DUC, mais c’est aussi un hommage amplement mérité pour eux deux…
B- La façade droite (en regardant l’horloge)
Nous avons déjà évoqué ci-dessus la voute céleste présente sur le cadran inférieur de la façade.
Sur le cadran médian, nous retrouvons comme sur la façade gauche une scène maritime animée, cette fois-ci avec un bateau devant le château de Montorgueil, ancienne prison dont on trouve encore les ruines à Jersey 5.
C’est le planétaire qui retiendra surtout notre attention. Ce cadran porte en son centre le Soleil, autour duquel orbitent les planètes. En pourtour, nous retrouvons le zodiaque de l’écliptique.
L’étendue est curieusement limitée aux six premières planètes du système solaire, et ne va donc pas au-delà de Saturne, alors que l’horloge a été inaugurée en 1869 6. En effet Uranus avait été découverte par William Herschel le 13 mars 1781, et Urbain le Verrier avait prouvé l’existence de Neptune le 23 septembre 1846. C’est donc que Monsieur Vérité a voulu se cantonner aux planètes visibles à l’œil nu…
Là aussi la vitesse de déplacement des planètes est respectée. Saturne par exemple opérera un tout complet de ce cadran en 29,5 années, Mercure en 687 jours.
Pour aller plus loin :
- Description de l’horloge monumentale de la cathédrale de Beauvais conçue & exécutée par M. A. L. Vérité. Amiens, Imprimerie Caron, 1876. (Disponible sur gallica.bnf.fr)
- I. Goux et C. Martin, L’horloge astronomique, E.S.P.A.C.E.S. Beauvais. (Guide descriptif réédité régulièrement et disponible à la Cathédrale).
- J-P Crabbe, Chr. Mange, O. de Mercey, L’heure de vérité: Horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais, Editions Monelle Hayot 2021. (Très richement documenté et illustré, l’ouvrage de référence. Disponible à la Cathédrale ou sur Amazon).
1 – En effet, l’horloge vue de loin ne nous présente que sa face avant à cause de la grille qui oblige à respecter un certain recul.
2 – De l’Oise à la Lune, Léon Fenet, photographies 1883-1898, dir. Bruno Ricard, Archives de l’Oise, 2012. Ouvrage consultable à la bibliothèque de Repères.
3 – James Stevens Curlin, Ferdinand Quenisset , pionnier de l’astrophotographie, S.A.F. 2023, p. 13.
4 – Simon Lericque, Petite histoire de la sélénographie, La porte des étoiles n° 66, p. 15. (Parution du GAAC).
5 – Cette scène d’une prison anglo-normande est à droite pour nous, mais à gauche du Christ qui surplombe toute l’horloge. Anglophobie de l’auteur en plein Second Empire ?
6 – D’abord au Palais de l’industrie de Paris.
![]()